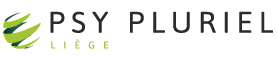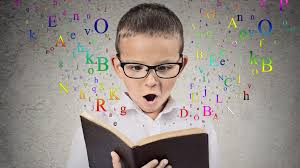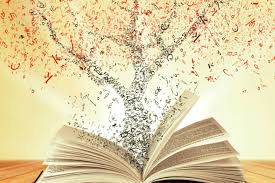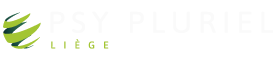Nora Marino
À partir de quel âge faut-il parler de la mort aux enfants ?
Il est important de leur en parler dès la naissance. Bien que les bébés n’aient pas la capacité à comprendre ni à se souvenir, ils sont sensibles à nos réactions corporelles, aux changements, au manque et à l’absence. Ainsi, leur parler permet de leur faire ressentir, voir et entendre ce qui leur est destiné. Exprimer son propre chagrin peut également s’avérer libérateur pour les enfants puisqu’ils sentent toutes les émotions qui traversent les adultes.

Comment formuler cette discussion ?
Les enfants vivent cruellement le silence et le tabou et il manque fréquemment d’interlocuteurs pour pouvoir parler de la perte d’un parent défunt. Ce n’est pas facile de trouver un adulte qui se sente suffisamment à l’aise avec toutes ces questions autour de la mort et en qui il peut faire confiance. Au-delà du malaise de l’adulte, il est conseillé de répondre aux questions le plus simplement et franchement possible. Pour un enfant, un mot est un mot et les métaphores comme « papa est parti » ou « maman s’est endormie » ne doivent pas être utilisés. S’endormir et sans doute le pire mot utilisé car il peut provoquer les troubles de l’endormissement chez l’enfant au même titre que si la personne décédée l’est de maladies, il faut pouvoir expliquer à l’enfant qu’elle souffre d’une maladie grave sinon il pourrait penser qu’il est susceptible de mourir s’il attrape par exemple un rhume.
La mort repose sur des principes fondamentaux : elle est inévitable et universelle, non fonctionnelle, permanente et irréversible et elle relève d’un certain nombre de causes réalistes. Selon son âge l’enfant aura acquis (ou non) ces principes et sera capable de les utiliser dans sa vie personnelle. L’universalité et la non-fonctionnalité s’acquiert progressivement entre 4 et 6 ans. Lorsque le pilier d’universalité n’est pas acquis, l’enfant peut penser que seules les vieilles personnes sont susceptibles de mourir. Pour la non-fonctionnalité, le petit qui n’aurait pas encore appréhendé le fait que les fonctions vitales du défunt se soient arrêtées peut se poser la question : «Papa est mort mais il peut toujours faire du vélo ? ».
À partir de 6-7 ans, l’enfant va commencer à concevoir la perception des causes réalistes et cet apprentissage se poursuivra jusqu’à ses 11 ans. Avant l’acquisition de cette perception, l’ enfant ignore que la mort relève d’un certain nombre de causes réalistes et c’est ainsi que peut arriver la question : « Est-ce que maman est morte parce que je l’avais fâchée ? »
la dernière étape s’observe à l’âge de 12 ans, lorsque les plus jeunes se font une représentation du caractère inexorable, irréversible et définitif de la mort. Ils deviennent capables d’associer cela à la perte des fonctions vitales. Il n’est pas rare que les enfants un peu plus grands passent rapidement d’une chose à une autre. Ils peuvent connaître l’idée de la mort tout en ne l’acceptant pas et en disant : « quand papa va rentrer, on pourra ….. », ce qui peut paraître déroutant pour le parent mais qui reste tout à fait normal.
Les enfants contrairement aux adultes peuvent ne pas être dans une tristesse ou une colère profonde. Ils peuvent passer d’une émotion à une autre ils semblent naturellement plus résilients, ils paraissent souffrir beaucoup moins que les adultes. En revanche, cette souffrance peut durer plus longtemps.
Autre réaction possible chez les enfants est qu’ils pensent que la mort peut être contagieuse. Si l’enfant est confronté à cette particularité, il peut perdre de son autonomie, s’accrocher à la personne qui reste ou la surveiller c’est-à-dire l’absence le place dans une grande insécurité. Des difficultés ou des problématiques plus comportementales peuvent apparaître : aller à l’école par exemple…. Il ne pourra plus vérifier si son parent a besoin d’aide ou que tout se passe bien pour lui. Des troubles de l’endormissement peuvent également apparaître, des régressions comportementales ,des difficultés scolaires……sont des signaux importants à prendre en compte.