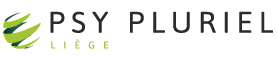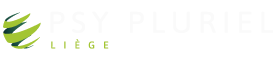William PITCHOT
Aujourd’hui, nous ne consommons plus principalement en fonction de nos besoins réels, ni même en fonction de nos envies profondes, mais bien selon la capacité de nos achats à susciter de la jalousie chez les autres (en particulier sur les réseaux sociaux). Ce glissement n’est pas anodin. Il marque une transformation silencieuse mais profonde de nos comportements, influencée par les logiques de visibilité, de comparaison et de reconnaissance sociale.
Les réseaux sociaux ont déplacé la finalité de la consommation. Acheter ne sert plus uniquement à se faire plaisir, à se nourrir ou à se vêtir, mais à se montrer, à exister aux yeux des autres, à produire une image enviable. Nous ne cherchons plus seulement à posséder, mais à exposer. Ce que nous partageons devient une sorte de vitrine sociale, construite pour provoquer des réactions, et idéalement de l’admiration mêlée d’envie. Plus encore que le plaisir personnel, c’est le regard des autres qui valide nos choix. Le « like », le commentaire, l’émoticône jaloux deviennent une forme de gratification émotionnelle.
Dans ce contexte, la jalousie suscitée devient une nouvelle forme de pouvoir symbolique. Elle alimente l’algorithme, elle génère de la portée, elle accroît la visibilité. Les plateformes numériques, qui fonctionnent par amplification émotionnelle, privilégient les contenus qui provoquent des réactions fortes : luxe, beauté, vacances idéales, mode, réussite. L’objectif implicite n’est plus seulement de montrer ce qu’on aime, mais de faire ressentir à l’autre ce qu’il n’a pas.

Cette logique de la consommation performative repose sur un mécanisme bien connu: la comparaison. En étant constamment spectateur de la vie (souvent mise en scène) des autres, nous devenons plus vulnérables à des sentiments d’insatisfaction, d’échec ou d’infériorité. Et pour compenser, nous consommons à notre tour, non pour combler un vide intérieur, mais pour reprendre place dans la hiérarchie symbolique numérique.
Nous sommes ainsi passés d’un capital économique ou culturel à un nouveau type de capital : le capital de visibilité. Ce que l’on possède ne vaut que par sa capacité à être vu, aimé, commenté. Acheter une paire de chaussures, une montre ou un voyage, c’est aussi acheter un fragment d’image sociale. On ne consomme plus seulement pour soi, mais pour alimenter sa « marque personnelle ».
Mais cette logique, aussi dominante soit-elle, n’est pas universelle. Elle touche particulièrement les jeunes générations, surexposées aux plateformes, mais elle coexiste avec des mouvements de résistance : minimalisme, décroissance, slow life, boycott des réseaux, valorisation de l’authenticité ou de l’invisibilité choisie. Ces contre-courants rappellent que le sens peut encore guider nos choix, que la consommation peut redevenir silencieuse, intime, ancrée dans le besoin réel ou le désir sincère.
Cependant, le constat reste préoccupant : dans une société où l’image prévaut sur l’expérience, où la reconnaissance passe par la mise en scène, la consommation devient moins un acte de liberté qu’un outil de validation sociale. Et cette course à la jalousie, bien qu’elle puisse flatter l’ego sur le moment, creuse souvent en retour des sentiments de vide, d’épuisement et d’isolement.