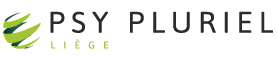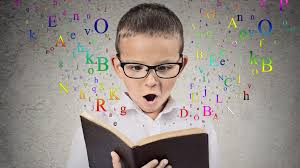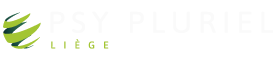Dr Patricia Piront
Les femmes qui se présentent à la consultation d’alcoologie ont chacune un parcours différent mais partagent des souffrances comparables.
Le point commun systématique dans le discours de chacune sont les mots suivants : « J’ai tellement honte », « Je m’en veux tellement ».Sentiment de honte, culpabilité et dissimulation sont 3 piliers qui pourraient définir la maladie alcoolique féminine.
Il s’agit d’une maladie grave et douloureuse, responsable d’un véritable tsunami personnel, interpersonnel et familial, lié à la consommation d’une drogue dure à cette époque où les femmes tâtonnent, essayant de revendiquer une place, qui ne soit pas égale ou supérieure, mais juste une parité éclairée…A cette époque également où la médecine moderne s’enorgueillit d’une prise en charge de plus en plus individualisée, presque à la carte génétique…
#balancetonalcoolauféminin pour que les droits de la femme soient aussi le droit à la maladie et aux assuétudes.
Le regard de l’historien :
Les femmes ont été longtemps interdites d’alcool. La Bible leur interdisait cette « boisson enivrante ». L’Antiquité infligeait aux buveuses des sanctions allant jusqu’à la mort. D’une manière générale, la consommation d’alcool était (et est peut-être toujours) considérée comme l’apanage des femmes « de mauvaise vie ».
Vers la fin du 18ème siècle, la dépendance et l’abus d’alcool commencent à être considérés comme des problèmes de santé, physique et mentale, au-delà des considérations juridiques et surtout, morales, qui dominaient jusque-là.
Au 19ème siècle, l’alcoolisme est considéré comme une maladie, une marque de dégénérescence de la classe
dominée. Peu à peu, les consciences évoluent et l’idée d’un alcoolisme féminin émerge ; ce concept permet même de renforcer la disparité avec comme argument choc : l’alcoolisme est un fléau, il y a MÊME des femmes qui boivent !
Arrivent d’ailleurs, avec les premières publications scientifiques et les écrits de grands auteurs classiques (Dickens et Zola par exemple), les premières sociétés de tempérance, basées sur la morale et la religion et prônant uniquement l’abstinence.
Ces sociétés, s’appuyant sur l’opinion médicale, font pression sur les pouvoirs politiques ; c’est à ce moment que les premières législations en rapport avec la consommation d’alcool apparaissent.
Grâce à ces mêmes sociétés, des services hospitaliers spécialisés et centres de cure se développent ; de nouveaux traitements (apomorphine et disulfirame) sont progressivement prescrits. L’alcool devient ainsi un enjeu majeur économique et social mais également un vaste problème de santé publique au cours de la première moitié du 20ème siècle.
A partir des années 40, le corps médical s’intéresse de plus en plus au concept de l’alcool chez la femme ; celles-ci jouent un rôle clé dans les stratégies de prise en charge ou de prévention ; elles sont souvent stigmatisées et réparties caricaturalement en deux groupes sans appel : « la femme alcoolique » et « la femme de l’Alcoolique ».
De nombreux stéréotypes sont ainsi amplifiés dans un discours au départ masculinomédical : l’homme va au café boire en bonne compagnie, la femme boit seule dans sa cuisine et cache ses consommations. Ces stéréotypes permettent de nourrir le concept de la femme, à la fois dissimulatrice et porteuse de honte, qui influence grandement leur prise en charge.
En effet, face au fléau alcoolique, la société et le corps médical n’auront pas la même indulgence pour les femmes que pour les hommes ; la distinction est ainsi rapidement faite entre l’homme, NORMAL, malheureusement et tristement alcoolique, et la femme ANORMALE, névrotique ou psychotique ET alcoolique ; selon les extrapolations personnelles de nombreux soignants, l’idée suivante est largement répandue : les maladies psychiatriques sont beaucoup plus souvent associées aux assuétudes chez la femme que chez l’homme. En revanche, une fois le droit de vote acquis, le rôle et la place de la femme dans l’étude de la maladie alcoolique et la lutte anti alcoolique, perd du terrain dans une tentative de réorganisation des familles et de la société après le choc des révolutions féministes. Dans les années 60 et 70, les apports du féminisme tentent de changer les mentalités dans le domaine de l’alcoologie ; est mise en avant la notion de conflit des rôles multiples endossés par les femmes, censées être dotées de super pouvoirs ( avec obligation de résultats) dans les domaines familial, sociétal puis, avec la féminisation, le domaine professionnel ; on essaie d’attirer l’attention sur les conditions de vie féminines et la surcharge mentale à l’origine des dépendances, ainsi que le manque criant de considérations.
A l’heure actuelle, on constate encore et toujours une fréquence et un mode de consommation différents en fonction des genres et le débat d’un alcoolisme féminin reste ouvert. Ce discours peut difficilement être exempt d’une note de féminisme, la condition de la femme dans notre société patriarcale influençant toujours les comportements et facteurs de risque.

A suivre …..