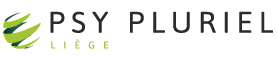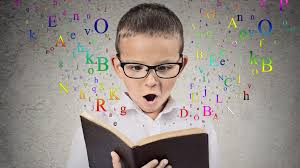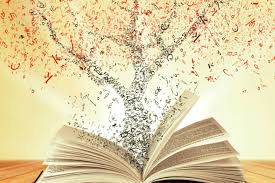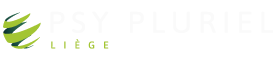Un diagnostic flou et changeant
William PITCHOT
Le terme dépression est largement utilisé en psychiatrie comme dans le langage courant, mais avec des significations très différentes. La dépression est tantôt considérée comme une réaction émotionnelle adaptée aux circonstances difficiles de la vie, tantôt comme « le signe d’une fragilité », tantôt comme « un luxe », parfois comme une maladie. En fait, la dépression clinique ou dépression caractérisée est un véritable trouble mental, « une vraie maladie ». Dans les pays européens, la dépression est même une des maladies les plus fréquentes. Dans une étude portant sur un échantillon de la population européenne, la prévalence (nombre de cas dans une population à un moment donné) à 12 mois de la dépression unipolaire était de 6,9 %. La dépression est même considérée aujourd’hui comme un problème majeur de santé publique. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la dépression est actuellement une des principales causes de handicap dans les pays développés avec les affections ischémiques cardiaques et les affections cérébro-vasculaires, les accidents de la route, les affections pulmonaires obstructives ou les infections respiratoires basses. En outre, le fardeau qu’elle représente devrait continuer à croître de manière très significative au cours des prochaines années, notamment en relation avec les différentes catastrophes auxquelles sont confrontées les populations (le réchauffement climatique, la pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine, les conflits au Proche-Orient ou la crise énergétique).
La dépression est une maladie grave. Elle est notamment associée à un risque suicidaire élevé, mais aussi à une comorbidité (association de maladies) somatique importante, notamment cardio-vasculaire. La dépression a aussi des conséquences dramatiques sur le plan économique. Au-delà du coût de la prise en charge, la dépression entraîne une réelle incapacité à travailler et à maintenir un niveau de revenus acceptable, mais a aussi un impact évident sur la participation de l’individu à la productivité de l’économie. Dans les pays développés, avec les troubles anxieux, la dépression représente une des premières causes d’absentéisme.
Cependant, le diagnostic et le traitement de la dépression sont loin d’être évidents, notamment à cause de la stigmatisation dont sont l’objet les personnes déprimées et les antidépresseurs sensés les aider. En effet, ce diagnostic reste très mal considéré auprès du public. La dépression a toujours la réputation d’une maladie honteuse, associée à un état de paresse, à une faiblesse de caractère ou à un risque d’évolution vers la folie. Au terme dépression, on préfère en général épuisement, fatigue psychique ou burn-out. En bref, on se défend d’être déprimé. Aujourd’hui, dans la société, la dépression a une bien mauvaise réputation.
Comment réagir face à une perception aussi stigmatisante d’une maladie pourtant si fréquente et si douloureuse ? Comment nous adapter à cette mauvaise réputation et ainsi retrouver de la crédibilité auprès de nos patients ? On doit susciter la réflexion autour du problème de la stigmatisation, et de manière plus précise d’appréhender la réalité scientifique, psychologique et sociétale du concept de dépression et de son traitement notamment avec les antidépresseurs. Le pari qui est pris est de faire preuve de plus de précision et d’honnêteté dans l’information donnée sur le trouble dépressif et les médications qu’on est parfois amené à proposer au patient.

La dépression : Un diagnostic flou et changeant
Le diagnostic de dépression reste aujourd’hui basé sur l’approche catégorielle du DSM-5 (système de classification des troubles psychiatriques). Ce système de classification diagnostique utilise des critères opérationnels, à la fois d’inclusion et d’exclusion, basés sur la psychopathologie descriptive apparente plutôt que sur des interprétations concernant la cause présumée, qu’elle soit psychologique, sociale ou biologique. Cet outil peut évidemment avoir une certaine utilité en favorisant la communication entre les cliniciens et les chercheurs, mais peut aussi générer des insatisfactions, les diagnostics proposés reflétant mal la complexité de la maladie mentale. Les symptômes fondamentaux faisant partie du diagnostic de dépression majeure comprennent l’humeur triste, la perte d’intérêt ou de plaisir, la perte d’énergie, les troubles du sommeil, les modifications de l’appétit, les troubles cognitifs (troubles de l’attention et pertes de mémoire), le ralentissement psychomoteur, les sentiments de culpabilité et l’idéation suicidaire. Ces symptômes peuvent varier très fort d’un patient à l’autre en termes de sévérité et de chronicité, et être associés à d’autres symptômes évocateurs d’autres affections psychiatriques. En outre, chez un même patient, ces symptômes peuvent changer au cours du temps. La grande diversité dans les présentations symptomatiques a conduit au développement de sous-groupes diagnostiques de dépression. La définition de ces entités diagnostiques est en adéquation avec le modèle médical classique de classification des maladies. Cependant, en psychiatrie, cette approche catégorielle (en résumé : coller une étiquette sur un patient) a des limites de plus en plus évidentes. En particulier, l’absence d’origine claire aux troubles de l’humeur n’autorise pas l’établissement d’entités diagnostiques hermétiquement constituées. Par ailleurs, nous restons dans l’incapacité de découvrir des marqueurs biologiques susceptibles de valider l’établissement d’une classification diagnostique basée sur cette biologie.